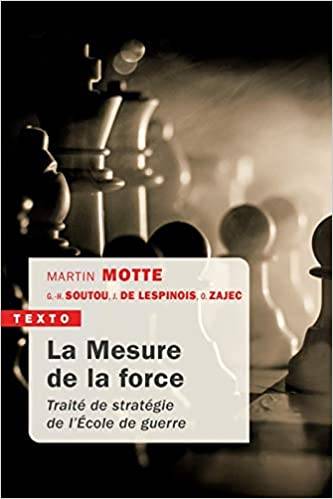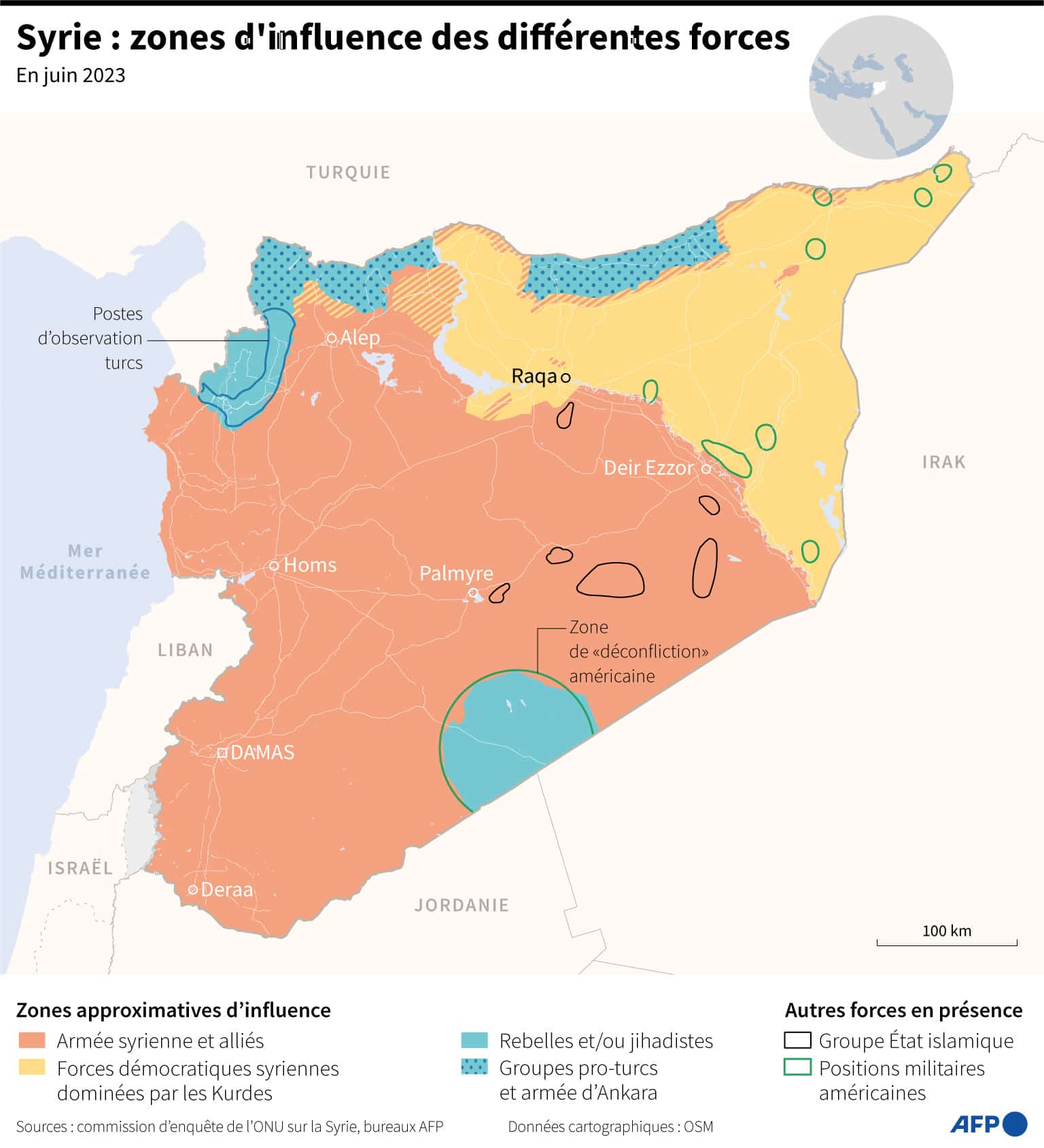Entretien de Jean-Baptiste Noé avec Martin Motte, Directeur d’études à l’EPHE et coauteur de La mesure de la force. Traité de stratégie de l’École de guerre, Tallandier, 2018.
Cet article est la retranscription d’une partie de l’émission réalisée en 2018 avec Martin Motte. Vous pouvez écouter le podcast de l’émission à cette adresse.
Nous publions cette version écrite de l’entretien à l’occasion de la sortie de La Mesure de la force en format poche.
Jean-Baptiste Noé : Cet ouvrage de référence pour élèves officiers et de ceux qui s’intéressent à la stratégie est coédité avec l’École de Guerre. Qu’est-ce que l’École de Guerre, quelles sont ses fonctions ?
Martin Motte : L’École de Guerre forme les officiers en milieu de carrière, au contraire des écoles de formation initiale (Saint-Cyr, école navale, Salon-d-P). Dans leurs 15 premières années, les officiers sont spécialisés dans une arme. L’École de Guerre leur enseigne, sur concours, à raisonner au-delà, au niveau interarmées.
JBN : Peut-on apprendre à être un stratège ? La stratégie, sont-ce des recettes que l’on apprendrait à l’école de guerre et que l’on appliquerait ensuite sur le terrain avec des succès immédiats ?
MM : Il n’y a pas de réponse péremptoire à un problème de stratégie, mais pour le borner, il faut des points de repères conceptuels et historiques. Napoléon avait un génie guerrier cultivé par la lecture : il connaissait l’Égypte à son arrivée grâce aux campagnes d’Alexandre etc., en Italie il connaissait l’histoire romaine. Il a ainsi gagné du temps dans l’intelligence du théâtre d’opération. L’Ecole de Guerre donne les clés pour accélérer le rythme de réflexion et l’emporter donc sur l’adversaire par l’initiative. Qui pense plus vite prend l’ascendant.
JBN : Faire la guerre aujourd’hui ce n’est plus la même chose que par le passé. L’histoire militaire, avec Thucydide et Napoléon, est-elle encore utile aux militaires avec les évolutions technologiques récentes ?
MM : Evidemment, on ne peut pas transposer Alexandre à l’heure du missile. Le changement est aussi sociologique : la première armée à passer à la conscription prend l’ascendant. Mais, derrière ces changements dans les procédés de combat, il y a des permanences. L’homme n’a pas changé dans sa structure cérébrale et nerveuse, dont les capacités n’ont pas évolué depuis la préhistoire. C’est toujours l’homme qui fait la guerre et doit se projeter dans le système mental de l’ennemi. Que cela passe par un casse-tête en silex il y a 25 000 ans ou par un virus cyber aujourd’hui, la surprise reste la surprise, qui est l’une des clés de la stratégie.
JBN : Chaque pays a ses écoles de guerre. Y a-t-il une approche différente de la stratégie chez les Anglais, les Allemands, les Américains, les Français… ?
MM : Oui, on parle de culture stratégique. C’est d’abord le résultat d’une géographie, qui donne une coloration stratégique. En GB, on a surtout raisonné en termes de stratégie navale. En France dont la capitale se trouve à quelques centaines de kilomètres d’une frontière sans barrière physique, le primat va aux forces terrestres. L’histoire donne aussi une coloration, comme la vocation messianique pour les Américains. Il y a aussi le rapport à l’industrie, certains misant plus sur des ressources industrielles qu’humaines, comme les US pour qui la technologie est première dans la guerre. La formation des cadres militaires reflète ces spécificités.
JBN : On a l’impression aujourd’hui que les moyens techniques abolissent les questions géographiques. Est-ce toujours pertinent d’étudier la géographie dans ce contexte ?
MM : Demandez à un sous-marin nucléaire de voler à 20000 mètres d’altitude, ça posera problème : il y a une contrainte du milieu, massive. Les milieux sont maintenant interconnectés donc il y a une logique interarmées et englobante, passant par l’espace, des satellites de télécommunication qui mettent les forces en relation, ou encore davantage par le cyberespace, mais cela ne fait pas disparaître la spécificité de chacun. Il ne faut pas désapprendre le milieu parce que les machines le penseraient. Fin 2017, un bateau de l’US Navy a percuté un pétrolier au détroit de Malacca, la faute au GPS : des marins ont perdu les fondamentaux de la navigation. La technique qui s’intercale entre nous et la géographie ne nous dispense pas de la penser et de la comprendre.
JBN : On a appris la guerre des tranchées, puis la question du monde bipolaire et la dissuasion nucléaire pendant la guerre froide… En ce début de XXIe siècle, quelles sont les questions des grands thèmes de la guerre, comment les officiers français pensent-ils la guerre aujourd’hui ?
MM : Le vice des écoles de guerre en France était de préparer la guerre telle qu’on l’avait faite pour la dernière fois. On préparait la guerre napoléonienne avant 1914 alors que la puissance de feu des mitrailleuses a condamné les offensives en rase campagne, puis dans l’entre-deux-guerres on a préparé la guerre des tranchées et loupé le tournant des blindés, puis on s’est formé à la guerre mécanisée et on a mené une guerre contre-insurrectionnelle dans les rizières d’Indochine… On préparait toujours la guerre d’avant. Aujourd’hui, il y a un empilement de modèles de guerre, dont on ne sait pas lequel va prédominer : il y a les menaces qu’on qualifie d’asymétriques (terrorisme, insurrection, déstabilisation… y compris des déstabilisations non militaires comme la déstabilisation boursière ou la diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux…), dans le même temps il y a la résurgence de menaces étatiques avec la remontée en puissance militaire de la Russie, l’émergence d’une puissance militaire chinoise stupéfiante, l’acquisition par des pays comme l’Iran de capacités d’interdiction aérienne ou navale très fortes… Le plus probable est que domine la guerre hybride, une forme de guerre combinant moyens classiques et non conventionnels. Nous sommes face à un tournant international où les formes de conflictualité connues par le passé se combinent, c’est cela la guerre hybride.
JBN : Les interventions récentes de l’armée française ont un trait commun : on a l’impression d’une victoire facile au début sous la puissance du feu puis un enlisement pour des questions de terrain. Au Mali, la France manque d’hommes pour tenir un terrain aussi vaste, cela fait penser à la guerre du Vietnam ou finalement le plus fort perd. Y a-t-il une réflexion quant aux stratégies visant à gagner cette guerre ce type de guerre ?
MM : Tout dépend de ce qu’on appelle gagner une guerre. Pendant la guerre d’Algérie, dès 1960 le FLN est militairement vaincu, mais victorieux politiquement car la France n’a pas de perspective de sortie de guerre satisfaisante. Comment avancer dans des guerres dont les politiques ne savent pas à quoi elles doivent servir et comment en sortir ? Ce n’est pas gagnable, car on a substitué des catégories morales aux catégories politiques. Gagner une guerre c’était en principe trouver une issue négociée, qui avantage le vainqueur mais soit viable pour le vaincu, qui doit la voir comme un moindre mal par rapport à ce qu’il aurait pu perdre, sinon il fait durer la guerre. En Irak et Afghanistan, on n’arrive pas à proposer de solutions acceptables par le vaincu, qui est un « terroriste » à éradiquer. On ne peut gagner quelque chose qu’on n’a pas défini : il y a confusion des genres entre morale et politique. La poursuite de buts moraux ne peut avoir de solution politique.
JBN : Cela renvoie à la question de la « guerre contre le terrorisme », terme étrange. Le terrorisme est une arme… Est-ce qu’on ne dit pas cela pour ne pas vouloir dire contre qui ou quoi on est vraiment en guerre ?
MM : Oui, c’est un problème lié aux sociétés libérales avancées, qui sont dans un état de confusion mentale, ne comprenant plus ce qu’elles veulent et ce que peut accepter l’adversaire.
JBN : Tout le monde voit l’opération Sentinelle dans les grands centres urbains. L’armée française se prépare-t-elle aussi à des situations de guerre urbaine sur le territoire français ?
MM : Bien sûr, la guerre en milieu urbain prédomine depuis la Seconde Guerre mondiale. Un centre d’entraînement dédié au combat en zone urbaine a ouvert récemment. Des militaires sont engagés sur un théâtre intérieur, et c’est lui qui absorbe le plus de moyens à l’armée de terre aujourd’hui. Les responsables des attentats en 2015 sont attaqués chez eux et veulent faire baisser la pression sur eux, en frappant sur le territoire des gens qui envoient leur force les combattre. Vu les petites armées actuelles, fixer une partie de celles-ci dans notre pays revient à grandement diminuer la pression. C’était le cas aussi pendant la guerre d’Algérie, mais on avait alors une armée gigantesque à même de quadriller le territoire national et l’Algérie.
JBN : Le terrorisme a aussi amené la notion de guerre chez les civils, qui pouvaient s’en être dissociés : maintenant là la question de la stratégie est implicitement posée à tout le monde…
MM : Oui. Il y a dix ans, on trouvait à peine 3 ou 4 livres de stratégie ou d’histoire militaire dans une librairie, aujourd’hui les rayons sont fournis. Il y a une prise de conscience et pas uniquement du fait du terrorisme : le mythe de la marche de l’humanité vers la paix a été écorné depuis au moins une vingtaine d’années.
JBN : Dans les années 1960-70 on parlait beaucoup de stratégie spatiale dans la culture populaire, le cinéma ou la bande dessinée. Aujourd’hui, on y voit surtout la cyber-stratégie, alors que les progrès techniques dans le domaine spatial sont bien plus importants. Quelle est l’actualité de la question dans le domaine spatial ?
MM : L’informatique concerne tout le monde : tout le monde a un ordinateur et pourrait être touché par une attaque cyber. Un satellite ne se voit pas et on ne va plus sur la lune… Cela a pu contribuer au désintérêt. Pourtant l’espace est au cœur des questions militaires car il permet la télédétection, de voir et d’identifier tel djihadiste à l’autre bout de la terre, les télécommunications connectent bateaux de surface, sous-marins, avions, drones, unités etc., et la géolocalisation. Il y a une dépendance à cette technique et, si ces systèmes grillent, on ne saura plus faire. Certaines puissances essaient d’apprendre à se passer de ces moyens, comme la Chine qui recrée des unités de pigeons voyageurs en anticipant la saturation des réseaux satellitaires.
A lire aussi : La Russie en Méditerranée : une stratégie défensive
JBN : En effet, toutes les armées sont dépendantes de l’espace ce qui suppose une parfaite coordination, de même qu’entre marine et aviation pour les opérations menées dans les montagnes afghanes…
MM : Ces procédés de repérage, géolocalisation et surveillance par satellite sont très précieux pour les frappes aériennes. En contre-insurrection, les ennemis savent qu’ils peuvent se faire bombardés de loin et font des embuscades au plus près pour que ce ne soit pas possible sans toucher les soldats amis. Aujourd’hui, on arrive à le géolocaliser précisément et donc à faire des frappes rapprochées sans risque trop grand pour nous.
JBN : Quand on pense « stratège », on pense à Foch et de Gaulle… Y a-t-il des qualités de commandement que l’on retrouve chez tout stratège, qui le différencient de quelqu’un d’autre ?
MM : Chaque stratège a sa propre équation : l’un brille sur un aspect, l’autre sur un autre. Foch et de Gaulle sont des cas extrêmement différents : de Gaulle n’a commandé sur le terrain qu’en mai-juin 1940 mais avait un sens géostratégique extraordinaire, une vision planétaire du conflit avec ses interactions entre les continents, la mer et la terre, avec l’économie, l’idéologie etc., alors que Foch commande une armée sur des champs de bataille. Mais la stratégie est la capacité d’articuler l’action de forces sur le terrain (la tactique ou les opérations) avec la politique, c’est l’articulation du politiquement souhaitable et du militairement possible. De grands tacticiens peuvent gagner une bataille et perdre la guerre, et on peut gagner la guerre en ayant perdu des batailles, comme les Russes qui ont vaincu Napoléon sans lui infliger de défaite franche et nette.
JBN : Napoléon a tout gagné mais il a perdu. On le présente comme un grand stratège, mais l’était-il autant ? Peut-être est-ce sur la question politique justement qu’il a perdu ?
MM : Napoléon hérite d’une situation perdue d’avance. C’est la Révolution française, avant lui, qui a déclaré la guerre à l’Europe entière, avec des buts de guerre par définition inatteignables.
JBN : De même, on parlait davantage de dissuasion nucléaire dans les années 1960-1970. Est-ce qu’aujourd’hui avoir l’arme nucléaire est toujours important pour un pays ?
MM : Je le crois. Lorsque l’URSS s’est effondrée, les occidentaux ont fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle renonce à ses armes nucléaires, on a promis de l’aider si un voisin l’agressait, on sait ce que cela lui a coûté. De même, la Corée du Nord a amené les US à la table des négociations alors qu’ils ne voulaient pas entendre parler d’elle, grâce à sa capacité balistique, donc malheureusement je crois que le nucléaire revient en force.
JBN : L’un des avantages de la France aussi avec d’autres pays est d’avoir une capacité d’être présente sur l’ensemble de des continents par sa force maritime…
MM : Oui, c’est la question de la projection. Mais, d’une part, nos moyens de projection diminuent celle-ci : il faut avoir des bateaux pour se projeter, et des bâtiments ravitailleurs pour le pétrole… et leur nombre a baissé : nos capacités vont marquer le pas. D’autre part, il faut bien des forces terrestres à projeter. On distingue la projection de force, placer des hommes à terre, et la projection de puissance, le tir d’obus ou de missiles sur le littoral : on ne contrôle rien avec la seule projection de puissance, elle ne permet pas de piloter un processus de paix. Nos adversaires veulent nous fixer chez nous dans l’Hexagone avec des actes terroristes pour pénaliser notre capacité de projection, faible parce que notre armée et notre marine ont diminué.
JBN : Aujourd’hui, il n’y a plus de conflit direct entre France et Allemagne mais d’autres combats se passent sur le continent (Yougoslavie, Ukraine…), la paix n’est pas établie sur le sol propre des Européens. Pourtant, on parle de créer une armée européenne. Ils manquent de vision stratégique sur leur propre continent…
MM : Parler d’« établir la paix sur leur propre sol » suppose un sol propre ! Existe-t-il une Europe comme acteur politique et stratégique ? Il y a des actions en commun comme la lutte contre la piraterie somalienne mais le moteur en est la marine française, la réalité permanente est celle des Etats et nations. La France intervient en Afrique et l’Allemagne s’intéresse plutôt aux rapports entre Russie, Pologne et pays baltes. Si l’Europe existe comme acteur stratégique, ce n’est qu’une existence seconde, derrière les nations.
JBN : Cela renvoie au début de l’émission : la stratégie ce sont les éléments matériels et technologiques mais aussi une géographie, une culture et une histoire propre à chaque pays…
MM : Exactement. L’opération au Mali est un succès militaire mais n’a pas résolu le problème. L’opération en Libye a surtout eu un effet déstabilisant… Les gouvernements ont souvent mené la guerre pour des motifs flous, idéalistes au mauvais sens du terme, sans définir l’intérêt de la France et sans paix raisonnable possible.
A lire aussi : La guerre, le soldat et la ville